Partager cet article
Dans une contribution pour le World Happiness Report 2025 (chapitre 7), réalisée en collaboration avec Yann Algan (HEC, Cepremap), et Corin Blanc (Cepremap, Université Paris-Nanterre), nous expliquons comment le déclin du bonheur et de la confiance sociale, en Europe comme aux États-Unis, engendre une grande part de l’augmentation de la polarisation politique et des votes anti-système.
Dans le contexte des sociétés post-industrielles devenues de plus en plus individualistes, les attitudes subjectives jouent un rôle bien plus important, dans la formation des valeurs et du comportement électoral, que les idéologies traditionnelles ou la lutte des classes.
Au cours de la dernière décennie, les pays occidentaux ont connu une série de victoires politiques anti-système, du Brexit en 2015 à l’élection de Donald Trump en 2024. Pendant cette période, le ressentiment envers « le système » a augmenté dans la plupart des pays européens. La figure suivante illustre la montée mondiale des partis populistes anti-système tout au long du 20e siècle, à la fois à l’extrême gauche et à l’extrême droite, avec une forte augmentation depuis les années 1980.

Les électeurs remettent en question l’immigration et la mondialisation, le protectionnisme est en hausse, les attaques contre les experts et les médias traditionnels sont de plus en plus fréquentes. Ces tendances peuvent surprendre étant donné les niveaux de prospérité et de sécurité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin. Un certain nombre d’études suggèrent que cette vague anti-système trouve son origine dans une perte de confiance dans les partis politiques traditionnels, qu’ils soient de droite ou de gauche, et une perte plus générale de confiance envers les élites, donnant naissance à des « partis anti-partis ». Cette perte de confiance dans le système peut être attribuée à des facteurs économiques – insécurité économique croissante, mondialisation, automatisation – ou à des facteurs culturels conduisant à une opposition à la modernité et à une hostilité croissante envers les immigrés. Mais la question de savoir pourquoi certains électeurs malheureux réagissent à ces pressions en se dirigeant soit vers l’extrême gauche, soit vers l’extrême droite, est rarement abordée.
L’étude réalisée pour le World Happiness Report 2025 en son chapitre 7 propose un cadre nouveau où les attitudes subjectives telles que la satisfaction de vie mais aussi la confiance interpersonnelle éclairent les comportements politiques et électoraux.
Un nouveau paradigme pour expliquer les votes anti-système
La littérature scientifique a déjà établi l’importance des attitudes subjectives telles que la satisfaction de vie pour expliquer le comportement électoral. On sait que les personnes mécontentes accordent une confiance moindre aux partis politiques traditionnels, et plébiscitent des idées et des méthodes de gouvernement autoritaires, tant dans le contexte européen que dans celui du Brexit. Dans le contexte américain aussi, une faible satisfaction de vie a été un indicateur majeur de la victoire de Trump en 2016.
L’étude réalisée pour le World Happiness Report a la particularité d’ajouter la dimension de confiance sociale à celle de satisfaction de vie pour expliquer les comportements politiques et électoraux. Ces deux dimensions façonnent ensemble les idéologies politiques, économiques et culturelles des citoyens. La relation entre satisfaction de vie et confiance sociale permet de distinguer quatre groupes (cf tableau ci-dessous).
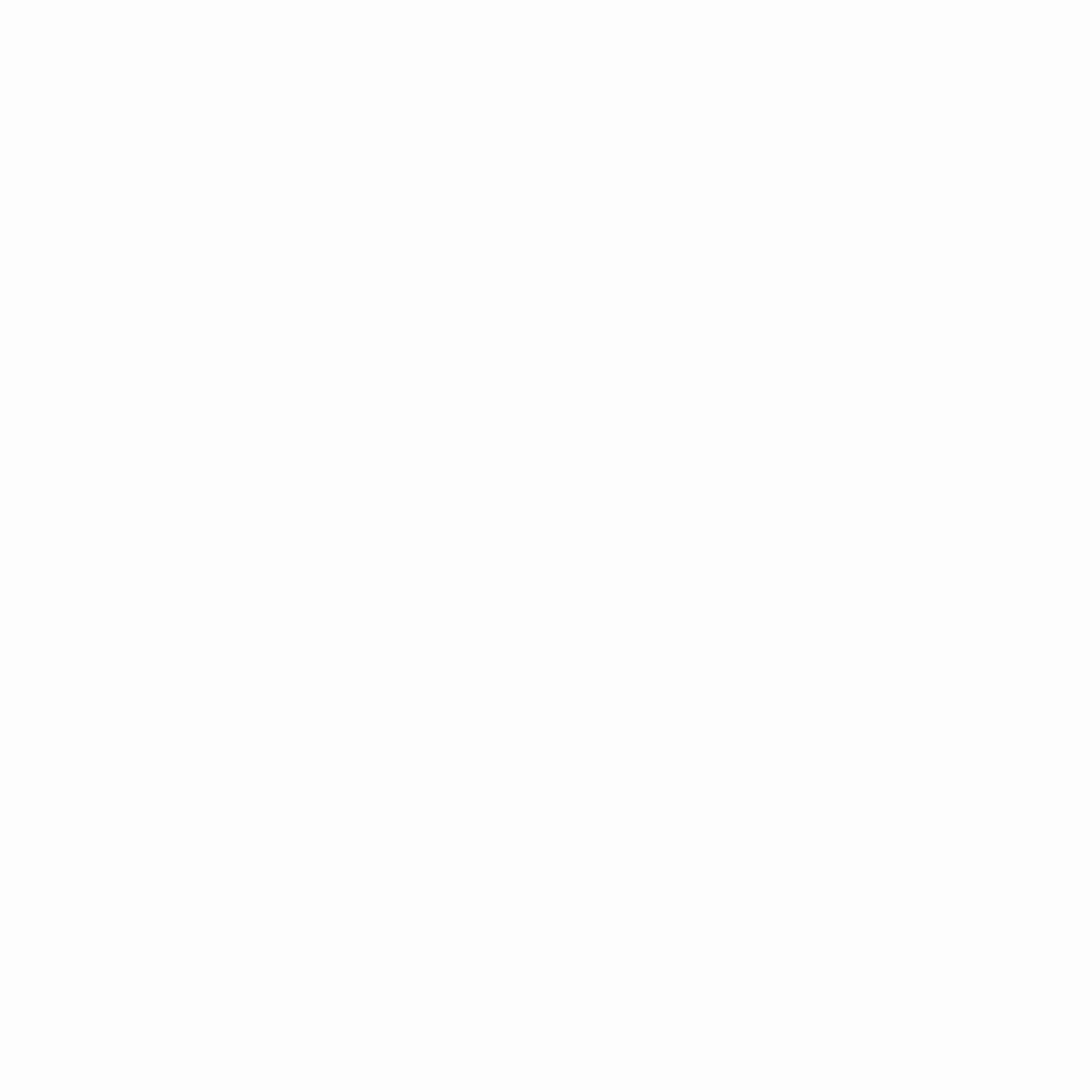
L’idéologie anti-système et la méfiance institutionnelle sont liées à une faible satisfaction de vie, mais la faible satisfaction de vie seule n’est pas suffisante pour générer un mouvement populiste d’extrême droite. L’extrême droite populiste se nourrit aussi de la faible confiance interpersonnelle, associée aux attitudes anti-immigration et anti-redistribution.
Cette partition se vérifie dans le cas des élections françaises. A la fois l’extrême gauche (Mélenchon) et l’extrême droite (Le Pen) ont des électorats importants (18-25 %) aux élections présidentielles de 2017 et 2022. Les électeurs de Le Pen et Mélenchon partagent un faible niveau de satisfaction de vie mais se distinguent par leur niveau de confiance (plus bas à l’extrême droite). Les mêmes schémas se retrouvent en Allemagne et en Espagne. Aux États-Unis, la démonstration est plus complexe étant donné le système bipartite (Démocrates/Républicains) qui protège les partis de la fragmentation. Cependant, on constate une scission non seulement entre les partis politiques, mais aussi entre les électeurs et les abstentionnistes, ces derniers affichant les niveaux les plus bas de satisfaction de vie et de confiance.
En Europe comme aux États-Unis, la satisfaction de vie et la confiance influencent de manière significative les valeurs politiques, économiques et culturelles, ainsi que le vote. Sur les deux continents, un faible niveau de satisfaction de vie est un terreau pour le populisme mais c’est le manque de confiance sociale qui distingue l’électorat d’extrême droite.